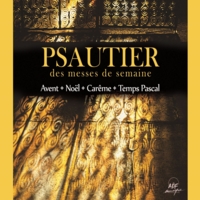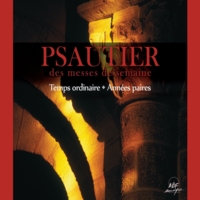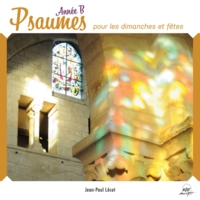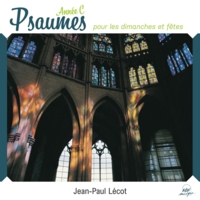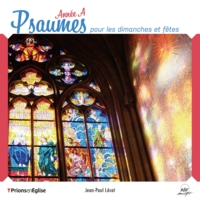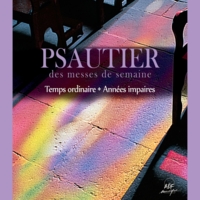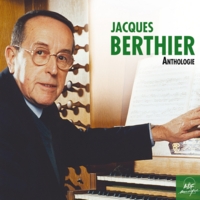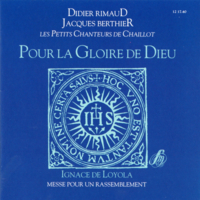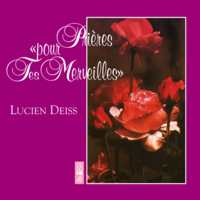Jacques Berthier (né le 27 juin 1923 à Auxerre - mort le 27 juin 1994 à Paris) est un compositeur et organiste, connu entre autres pour sa large contribution à la composition des chants de la Communauté de Taizé. Né à Auxerre (Bourgogne), ses deux parents étaient musiciens. Initié d'abord par eux, il étudia le piano, l'orgue, l'harmonie et la composition. Après la guerre il entra à l'École César-Franck de Paris où il eut, entre autres professeurs, Édouard Souberbielle et Guy de Lioncourt (avec la fille duquel il se maria). Il fut alors organiste de la cathédrale Saint-Étienne d'Auxerre succédant à son père Paul Berthier entre 1953 et 1960, puis de Saint-Ignace-de-Loyola, l'église des Jésuites à Paris, de 1961 à sa mort. Par ailleurs, il était l'oncle de la chanteuse France Gall. C'est en 1955 qu'il commença à composer pour Taizé, en ce temps-là communauté monastique d'une vingtaine de frères. En 1975, la Communauté fit à nouveau appel à lui pour la composition de chants méditatifs, souvent brefs mais repris longuement, voie de la prière commune à Taizé. Ce concept liturgique fut apporté par le défunt Frère Robert, qui recueillait et rédigeait les textes avant de les envoyer à Berthier avec des directives de mise en forme. La capacité de ce dernier à trouver l'accent juste des mots, même dans des langues qui lui étaient étrangères, et la créativité dont il fit preuve dans la mélodie et l'harmonie des voix ont contribué à la renommée de ce que l'on appelle souvent la " musique de Taizé ". En parallèle de ce travail, Jacques Berthier composa pour les paroisses catholiques traditionnelles, pour les grands rassemblements, pour les communautés monastiques, dans un style très personnel et qui fut toujours inspiré des modes grégoriens. Il mourut chez lui à Paris en 1994, et tint à ce que sa propre musique ne fut pas jouée lors de ses funérailles à l'église Saint-Sulpice. En 2006, le Jubilate Deo Award lui fut décerné à titre posthume, accepté par Frère Jean-Marie (Taizé). En plus de vingt ans, Berthier a laissé un important corpus (232 chants dans 20 langues différentes) aujourd'hui largement repris dans d'autres communautés et de par le monde. Il est également l'auteur de messes pour orgue, d'une cantate en forme de croix et une cantate pour Sainte Cécile.

Didier Rimaud était un jésuite, poète et compositeur français de chants chrétiens, né le 6 août 1922 à Carnac (Morbihan) et décédé le 24 décembre 2003 à Lyon. Bien que né à Carnac où se trouvait la maison de vacances de sa famille, Didier Rimaud a passé son enfance et ses études à Lyon, notamment au Lycée Saint-Marc. Sa famille nombreuse (8 enfants) était amatrice de musique et de chansons, et ses parents en composaient de temps en temps. Il devint jésuite en 1941, après un an de noviciat, puis a commencé à chanter dans une chorale des Petits chanteurs de Provence. Avec le Centre national de pastorale liturgique (CNPL), il commença dans les années 1950 à participer à l'écriture des textes en français de la liturgie catholique, mais aussi à donner des conseils pour le réaménagement de lieux de cultes. Selon Didier Rimaud, la traduction des textes liturgiques, anonyme, difficile puisqu'elle nécessite de rassembler et concilier les remarques de nombreux évêques, lui procurait une grande joie lorsqu'il entendait ces textes utilisés dans le culte. En 1952, il publie son premier chant liturgique, coté E 20 : Seigneur, venez. Dans les années 1970, à la suite du Concile Vatican II, la Compagnie de Jésus rappela à ses membres de ne pas dissocier l'annonce de la foi et la recherche de la justice sociale pour les plus pauvres. Cela marquera Didier Rimaud et influencera beaucoup ses compositions ultérieures. Avec Vatican II s'est faite sentir la nécessité d'élargir le répertoire des chants en français pour la liturgie : il fut alors très sollicité pour en écrire de nouveaux. Il travailla en collaboration avec des musiciens comme Jacques Berthier, Jo Akepsimas, Joseph Gelineau ou encore Christian Villeneuve. Il a également participé à la traduction liturgique de la Bible en français : cette traduction, destinée à être comprise à l'oral par des auditeurs lors d'une célébration, avait été faite dans les années 1970 pour les passages lus pendants les célébrations, mais n'a été complétée que dans les années 2000 pour l'ensemble de l'Ancien Testament.
Charlemagne réalisant que l'unité de son royaume se ferait par l'enseignement, crée des écoles et, en l'an 799, crée à Lyon une Ecole de Chant à la Primatiale Saint Jean. Les enfants apprennent la grammaire, les mathématiques et le chant. Et depuis 1 200 années, la Maîtrise de Lyon poursuit son chemin ... Jean-François Duchamp, Maître de Chapelle en prend la direction en 1974. Elle est la plus ancienne institution musicale de Lyon. Cette Maîtrise de cathédrale est actuellement une originalité en France. Uniquement composée de garçons (80 garçons de 10 à 25 ans), elle met en valeur la qualité vocale de leurs voix, l'étendue de la tessiture, la pureté du timbre, la puissance sonore. Rappelons que les Maîtrises ont été pendant des siècles le berceau de grands musiciens comme Palestrina, Bruckner, Bach, Purcell, Duruflé ... La création d'une école maîtrisienne en horaires aménagés au sein de l'Externat Sainte Marie de Lyon permet un enseignement musical approfondi (8 heures par semaine) dans une scolarité classique, formation vocale, solfège, harmonie et mise en place d'un répertoire qui recouvre toute l'histoire de la musique, du chant grégorien à nos jours. Cet enseignement permet une formation Individuelle, collective et spirituelle: